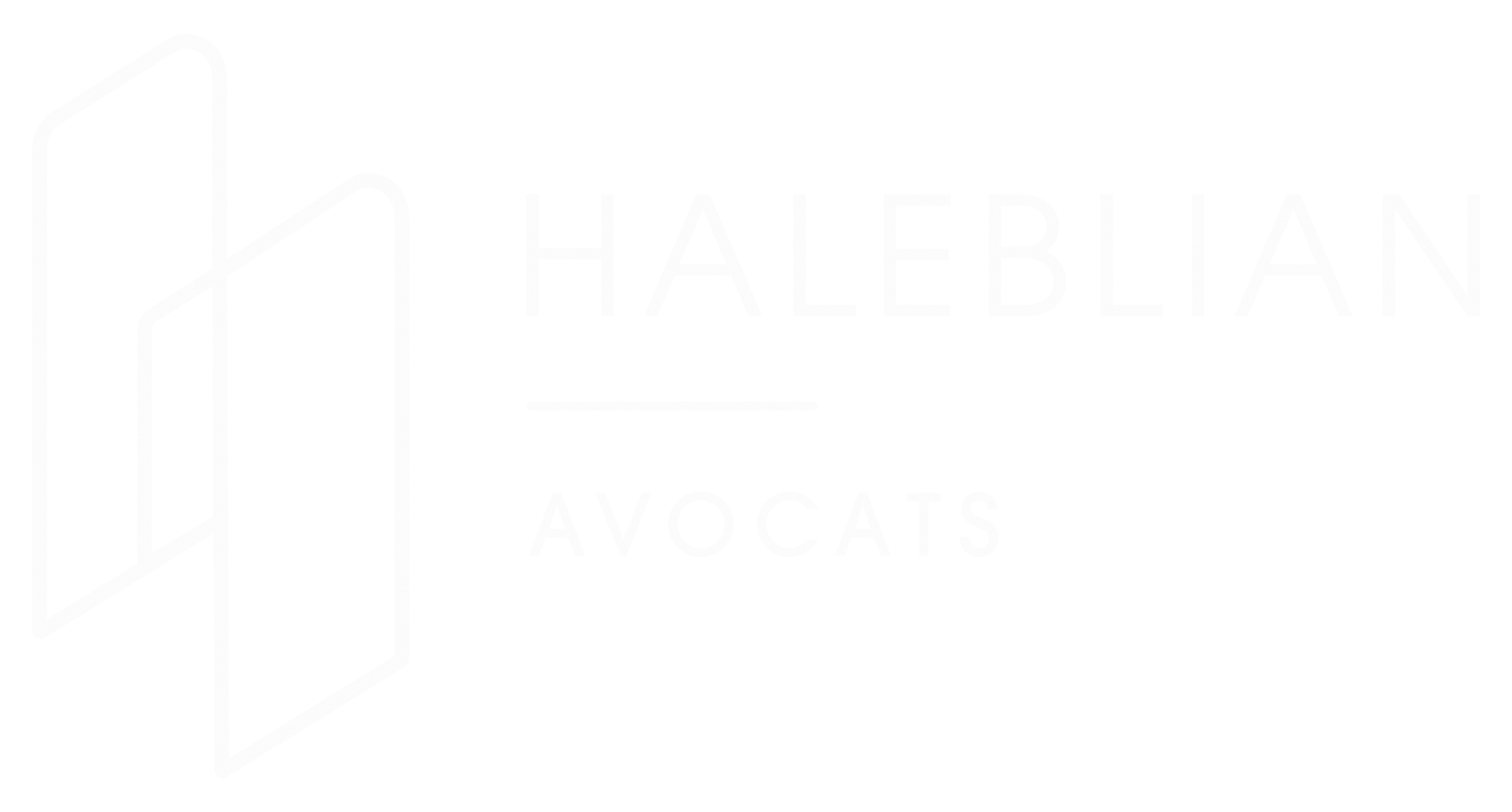Meurtre, assassinat et féminicide
Mieux
comprendre
Il est fréquent d’entendre parler de meurtre, d’assassinat voire de féminicide, notamment dans les médias, à l’occasion d’affaire impliquant la mort d’un individu commis par un tiers. Tous ces termes revêtent une réalité et des conséquences juridiques différentes.
Définitions légales du meurtre, de l’assassinat et du féminicide
Qu’est-ce qu’un meurtre ?
Le meurtre est un homicide commis de manière volontaire mais sans préméditation
Il est défini à ’article 221-1 du Code pénal comme le fait de donner volontairement la mort à autrui.
Exemple : Une dispute éclate entre deux individus, l’un d’eux, sous l’effet de la colère, poignarde mortellement l’autre sans avoir planifié son geste auparavant.
Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. La peine peut être alourdie allant jusqu’à la perpétuité, soit 30 ans de prison ferme dont 18 ans minimum sans possibilité de libération anticipée. Cette période peut-être allongée selon la gravité des faits.
Qu’est-ce qu’un assassinat ?
L’assassinat est un homicide commis de manière volontaire et avec préméditation.
Il est définit à l’article 221-3 du Code pénal précise que l’assassinat est un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Cela signifie que l’auteur a réfléchi et planifié son crime avant de passer à l’acte.
Exemple : Une personne ayant décidé de tuer un proche organise son acte en achetant une arme plusieurs jours avant et en l’attendant à un endroit précis.
L’assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (30 ans de prison dont 18 ans de sûreté a minima).
La période de sûreté peut-être allongée en fonction de la gravité des faits, pouvant aller jusqu’à ce qu’on appelle la « perpétuité incompressible », soit 30 ans de prison ferme sans possibilité de libération anticipée avant la fin de cette période.
Qu’est-ce qu’un féminicide ?
Le féminicide n’est, contrairement au meurtre et à l’assassinat, pas une infraction à proprement parlé sur le plan juridique. Le terme féminicide n’apparaît pas dans le Code pénal comme tel.
Il est cependant largement utilisé pour désigner le meurtre d’une femme en raison de son sexe, notamment dans un contexte de violences conjugales.
Le féminicide met en lumière les violences systémiques faites aux femmes et vise à sensibiliser l’opinion publique sur la réalité des homicides volontaires commis par des conjoints ou ex-conjoints.
Le féminicide est donc un meurtre en droit. Mais le fait que ce meurtre soit commis en raison du sexe de la victime lui fait revêtir une circonstance aggravante. Ces crimes sont souvent jugés comme meurtres aggravés, avec des circonstances spécifiques prévues par l’article 221-4 du Code pénal lorsque l’auteur est le conjoint, concubin ou ex-compagnon de la victime.
Bien que le mobile sexiste soit reconnu comme une circonstance aggravante dans l’article 132-77 du Code pénal, les tribunaux n’utilisent pas encore systématiquement le terme « féminicide », préférant se baser sur les qualifications existantes (meurtre aggravé, assassinat, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner). Cependant, la jurisprudence évolue, et la reconnaissance du mobile sexiste dans les affaires de meurtres de femmes permet une répression plus sévère : la Cour de cassation a confirmé la qualification de meurtre aggravé par le mobile sexiste, en relevant que l’auteur avait tué sa compagne en raison de son statut de femme et de sa volonté d’émancipation. Cette reconnaissance a permis d’alourdir la peine encourue (Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 14 février 2018 (n°17-81.767) ).
Le meurtre, l’assassinat et le féminicide sont qualifiés de crimes, ce qui signifie qu’ils sont jugés par une juridiction pénale spécifique : la cour d’assises.
La cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels et d’un jury populaire, qui décideront de la culpabilité de l’accusé et de la peine à prononcer.
Enquête et procédures
À partir de la découverte du corps de la victime, des constatations vont être établies, une enquête ouverte pour rassembler un maximum de preuves et identifier le ou les responsable(s).
Dans ce type d’affaires, il faut faire preuve de patience, notamment pour réunir un maximum d’éléments probants. Les procédures sont souvent très longues, ce qui est très éprouvant pour les familles de victimes. Pour les mis en cause, ce temps est également nécessaire pour éviter les erreurs judiciaires et garantir la validité des procédures.
C’est pourquoi il est impératif pour les ayant-droits et mis en cause de se faire accompagner par un Avocat spécialisé. Ce dernier permet de veiller au bon déroulement des procédures et veiller à la garantie des intérêts de ceux qu’il accompagne.
Constatation du décès et premières constatations
Lorsqu’un corps est découvert dans des circonstances suspectes, plusieurs acteurs interviennent immédiatement :
- Les secours (SAMU, pompiers) constatent la mort et vérifient la possibilité d’une intervention médicale.
- Les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) sont appelées pour sécuriser la scène et éviter toute altération des preuves.
- Le médecin légiste est requis pour établir un certificat de décès et détecter les premiers signes laissant supposer une cause criminelle (traumatismes, absence de cause naturelle, etc.).
- Le procureur de la République est informé et décide d’ouvrir une enquête.
Enquête préliminaire et ouverture d’une information judiciaire
Si la mort semble suspecte, le procureur ordonne une enquête en flagrance (si l’infraction vient d’être commise) ou une enquête préliminaire.
- Autopsie médico-légale : réalisée par un médecin légiste, elle permet de déterminer les causes exactes du décès (violence, arme, strangulation, empoisonnement, etc.).
- Exploitation des indices : relevés ADN, empreintes, objets suspects, vidéosurveillance, témoignages, etc.
- Auditions des proches et témoins : pour reconstituer les circonstances du décès.
- Premiers soupçons : si des éléments convergent vers un suspect, il peut être placé en garde à vue.
Le procureur peut ouvrir une information judiciaire et saisir un juge d’instruction lorsque les faits sont complexes ou nécessitent des investigations approfondies.
Garde à vue du suspect
Si un suspect est identifié, il peut être placé en garde à vue pendant 48 heures (ou 96h en cas de crime organisé) pour être interrogé.
- Il a droit à un Avocat et doit être informé des faits qui lui sont reprochés.
- La garde à vue permet aux enquêteurs d’interroger le suspect, de confronter ses déclarations aux preuves et aux témoignages.
- À l’issue de la garde à vue, le procureur peut classer l’affaire, le libérer ou présenter le suspect à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen.
Mise en examen et qualification des faits
Si les indices sont graves et concordants, le juge d’instruction peut mettre en examen le suspect pour :
- Meurtre (article 221-1 du Code pénal) : si l’auteur a donné la mort volontairement, sans préméditation (30 ans de réclusion criminelle).
- Assassinat (article 221-3 du Code pénal) : si la mort a été préméditée (réclusion criminelle à perpétuité).
Circonstances aggravantes
Des peines plus lourdes sont prévues si l’homicide est commis sur un conjoint, une personne vulnérable, une personne mineure, avec torture ou acte de barbarie, ou pour des motifs sexistes, ce qui est le cas du « féminicide ».
Après la mise en examen, plusieurs décisions sont possibles en attente du procès :
- Contrôle judiciaire (liberté sous conditions).
- Détention provisoire (si la gravité des faits l’exige).
Soit le mis en cause comparaît libre à son procès, soit il est décidé de le priver de sa liberté le temps du procès. Cette mesure intervient si le mis en cause est considéré comme potentiellement dangereux, pour préserver d’éventuels preuves ou témoignages, ou encore éviter une fuite.
Instruction judiciaire et préparation du procès
Le juge d’instruction mène une enquête approfondie.
Il pourra ainsi enjoindre aux forces de l’ordre de procéder à plusieurs types d’actions, comme une confrontation entre le mis en examen et les témoins, une reconstitution des faits, de nouvelles expertises médico-légales, ADN, balistiques, ou psychiatriques…
Le but du juge d’instruction est de diriger l’enquête de manière à rassembler un maximum d’éléments pour faire la lumière sur la vérité.
À l’issue de l’instruction, deux issues sont possibles :
- Un non-lieu : si les charges sont insuffisantes. Pour q’un procès puisse avoir lieu, il faut plusieurs éléments factuels sur lesquels les juges et jurés pourront s’appuyer. En l’absence de preuves suffisantes, un procès ne peut avoir lieu au risque de donner lieu à un jugement basé sur autre chose que des éléments tangibles (intuition, influence des médias etc.).
- Un renvoi devant une juridiction : si l’enquête a permis de rassembler suffisamment de preuves, l’affaire sera donc renvoyée devant la Cour d’assises pour établir ou non la culpabilité du mis en cause.
Le procès : jugement du mis en cause
Si le suspect est renvoyé devant une juridiction, le procès se déroule devant la juridiction compétente : la Cour d’assises (compétente en matière de crimes comme le meurtre, ou l’assassinat). Contrairement aux autres juridictions françaises, la Cour d’assises est composée de trois juges mais aussi d’un jury populaire composé de 6 citoyens français.
Depuis 2011, il n’est plus nécessaire que juges et jurés établissent la culpabilité de l’accusé à l’unanimité. La majorité qualifiée est suffisante, soit 6 voix sur 9. Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte, l’accusé est donc acquitté.
Pendant le procès, la présomption d’innocence est garantie. L’accusé peut être acquitté (Cour d’assises) si les preuves sont finalement jugées insuffisantes. Sinon, une condamnation est prononcée avec une peine adaptée.
Les parties peuvent faire appel de la décision.
Droits des victimes et des accusés
Dans les procès impliquant meurtre ou assassinat, les familles de victimes sont elles même considérées comme victimes au sens juridique mais aussi moral.
Il faut toutefois distinguer le volet civil du volet pénal.
Les deux procédures sont souvent liées, notamment par la présence et la reconnaissance des familles dans le procès pénal, mais elles ont des finalités différentes :
- Le pénal punit l’auteur.
- Le civil indemnise les victimes.
Droits des ayants droit des victimes
Dans un procès pénal, les ayants droit de la victime (famille, conjoint, enfants, etc.) peuvent se constituer partie civile. Cela leur permet :
✅ D’être reconnus comme victimes indirectes et d’avoir un rôle actif dans le procès.
✅ De réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi (moral, économique…).
✅ D’avoir accès au dossier et de demander des actes d’enquête complémentaires via leur Avocat.
Ainsi, le volet pénal (sanction de l’auteur) et le volet civil (réparation des préjudices) sont traités en même temps, dans la même audience, devant la cour d’assises.
Même si la cour d’assises statue sur les dommages et intérêts des parties civiles, une procédure civile peut être engagée en parallèle ou après :
▶ Si la condamnation ne couvre pas tous les préjudices, les proches peuvent saisir un tribunal civil pour demander un complément d’indemnisation.
▶ Si l’auteur du crime est insolvable, les familles peuvent solliciter la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), une juridiction civile qui indemnise les victimes à travers le Fonds de garantie des victimes.
Bien que la procédure pénale vise la punition de l’auteur et la procédure civile la réparation du dommage, elles s’articulent autour du même événement : le crime.
▶ Les familles sont présentes aux audiences pour comprendre les circonstances, faire entendre leur voix et demander justice.
▶ Le tribunal prend en compte leur douleur, notamment dans les réquisitions du parquet et les plaidoiries des Avocats.
▶ Une condamnation pénale facilite souvent l’indemnisation civile, car elle établit la responsabilité de l’auteur.
Droits de l’accusé
Être accusé d’un crime ne veut pas dire être coupable. Bien souvent, l’amalgame est fait entre ses deux notions. Si l’affaire est portée devant les médias, que des éléments de l’affaire sont communiqués, l’opinion publique se forge un avis sans pour autant connaître tous les éléments de l’enquête.
Il existe le principe de présomption d’innocence, qui est l’un des principes fondamentaux du droit pénal. C’est pourquoi, l’accusé sera toujours présumé innocent jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu.
L’accusé à le droit de se défendre. C’est pourquoi il est recommandé de faire appel à un Avocat dès le début de la procédure. Ce dernier pourra veiller à ce que l’ensemble de ses droits liés à sa défense soient respectés.
Je suis famille d’une victime d’un meurtre ou d’un assassinat
Vous êtes ayant-droits d’une victime de meurtre ou d’assassinat ? En tant que famille de victime, vous avez droit de vous porter partie civile au procès. Les procédures liées à des crimes sont très lourdes et complexes : n’hésitez pas à vous faire accompagner. Maître HALEBLIAN est spécialisée en droit pénal et pourra vous apporter son expertise et défendre vos intérêts..
Je suis accusé d’un meurtre ou d’un assassinat
En tant qu’accusé, vous bénéficiez de nombreux droits. Faire appel à un Avocat dès le début de la procédure vous assure une défense complète de ces droits. N’hésitez pas à contacter Maître HALEBLIAN pour faire un point sur votre situation.