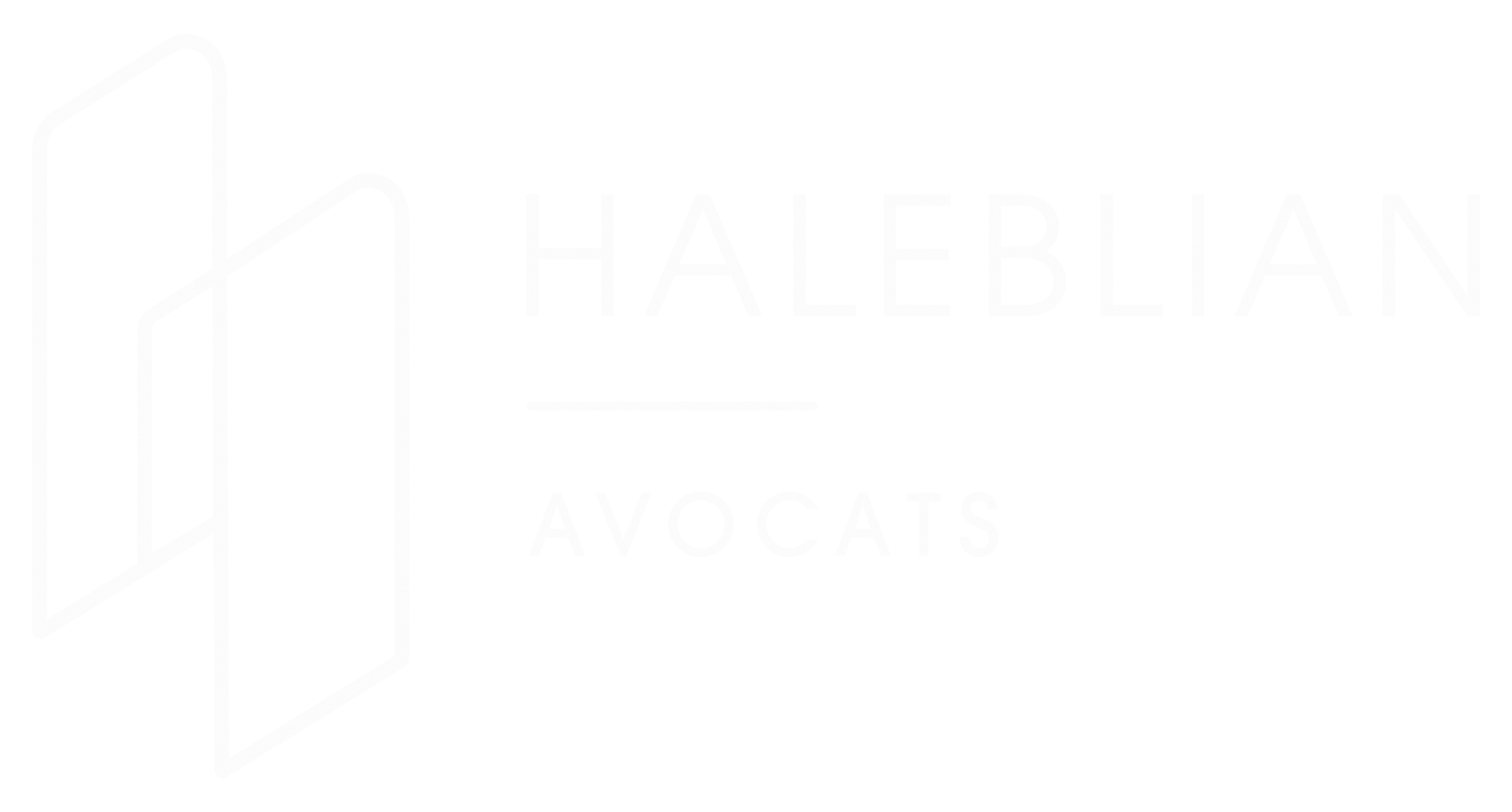Principes de la réparation du préjudice corporel
Mieux
comprendre
La réparation du préjudice corporel repose sur un ensemble de règles juridiques destinées à compenser intégralement les dommages subis par une victime à la suite d’un accident, d’une agression ou d’une faute médicale. En France, ce principe est encadré par le droit commun de la responsabilité civile et enrichi par une jurisprudence abondante qui garantit aux victimes une indemnisation la plus juste possible.
Le principe de la réparation intégrale
Le principe fondamental en matière de réparation du préjudice corporel est le principe de réparation intégrale, consacré par la jurisprudence et la doctrine. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1954, ce principe impose que la victime soit replacée dans une situation aussi proche que possible de celle où elle se trouvait avant le dommage, sans perte ni profit.
L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) pose le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte est le socle de l’obligation d’indemnisation lorsqu’une faute a été commise.
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 19 juin 2003 (Cass. Civ. 2e, n° 01-14.293) que la réparation doit couvrir toutes les conséquences du dommage, qu’elles soient patrimoniales (pertes financières) ou extrapatrimoniales (souffrances endurées, atteinte à la qualité de vie).
Les postes de préjudices indemnisables
La nomenclature Dintilhac, adoptée par les juridictions françaises, établit une classification des différents postes de préjudices indemnisables. On distingue principalement :
- Les préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles et futures (article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale).
- Pertes de revenus et incidence professionnelle (Cass. Civ. 2e, 10 décembre 2009, n° 08-19.885).
- Frais d’adaptation du logement et du véhicule pour les personnes devenues dépendantes (exemple : Cass. Civ. 2e, 14 décembre 2017, n° 16-26.687).
- Les préjudices extrapatrimoniaux :
- Souffrances endurées (Arrêt du 23 novembre 2017, Cass. Civ. 2e, n° 16-26.687).
- Déficit fonctionnel permanent et temporaire (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-17.558).
- Préjudice d’agrément (privant la victime de ses loisirs habituels, Cass. Civ. 2e, 4 février 2016, n° 15-10.201).
- Préjudice sexuel
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 19 mai 2016 (Cass. Civ. 2e, n° 15-18.344) que l’indemnisation ne pouvait être réduite pour des raisons économiques ou budgétaires et devait être complète.
L’indemnisation des proches de la victime
Les proches de la victime peuvent aussi prétendre à une indemnisation dans certains cas :
- Préjudice d’affection : reconnu par l’arrêt Dangereux de 1962, qui indemnise la souffrance morale d’un proche après un accident grave.
- Préjudice économique des proches : lorsqu’un membre de la famille doit cesser son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche devenu dépendant (Cass. Civ. 2e, 3 mars 2011, n° 10-17.951).
Dans une décision du 22 février 1995 (Cass. Ass. Plén., n° 93-11.474), la Cour de cassation a jugé que les enfants d’une victime décédée peuvent être indemnisés même s’ils n’étaient pas encore nés au moment des faits.
Les proches de la victime peuvent aussi être indemnisés au titre de leur deuil pathologique.
Le deuil pathologique désigne une réaction de deuil anormalement intense ou prolongée après la perte d’un proche, pouvant aller jusqu’à altérer durablement la santé mentale ou physique de la personne endeuillée.
Ce type de deuil peut se manifester par :
- une dépression sévère,
- des troubles anxieux ou du comportement,
- une perte d’autonomie sociale ou professionnelle,
- un besoin de traitement psychologique ou psychiatrique.
Le deuil pathologique entre dans la catégorie du préjudice moral personnel dans le cadre du droit de la responsabilité civile, notamment fondé sur :
- Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
- Le préjudice d’affection est classiquement indemnisé au titre du préjudice moral des proches (notamment en cas de décès ou de handicap grave d’un proche).
Mais dans le cas d’un deuil pathologique, on dépasse ce cadre : il est alors considéré comme un préjudice autonome.
La Cour de cassation admet que les proches d’une victime peuvent demander indépendamment du préjudice d’affection, la réparation du préjudice résultant d’un syndrome dépressif réactionnel lié au décès (Cour de cassation, 2e civ., 14 janvier 2016, n°14-29.820).
Faire appel à un Avocat en préjudice corporel pour obtenir une indemnisation
La réparation du préjudice corporel obéit à un principe fondamental : replacer la victime dans la situation la plus proche possible de celle qui était la sienne avant le dommage. Ce principe, consacré par la jurisprudence, s’accompagne de nombreux mécanismes permettant aux victimes de faire valoir leurs droits, que ce soit devant un juge ou dans le cadre d’une négociation amiable avec un assureur ou un fonds d’indemnisation.
Maître Natacha HALEBLIAN, spécialiste en droit du dommage corporel, accompagne les victimes dans la réparation de leur préjudice depuis plus de 10 ans, en veillant à obtenir une indemnisation juste et complète de leurs souffrances et de leurs pertes.