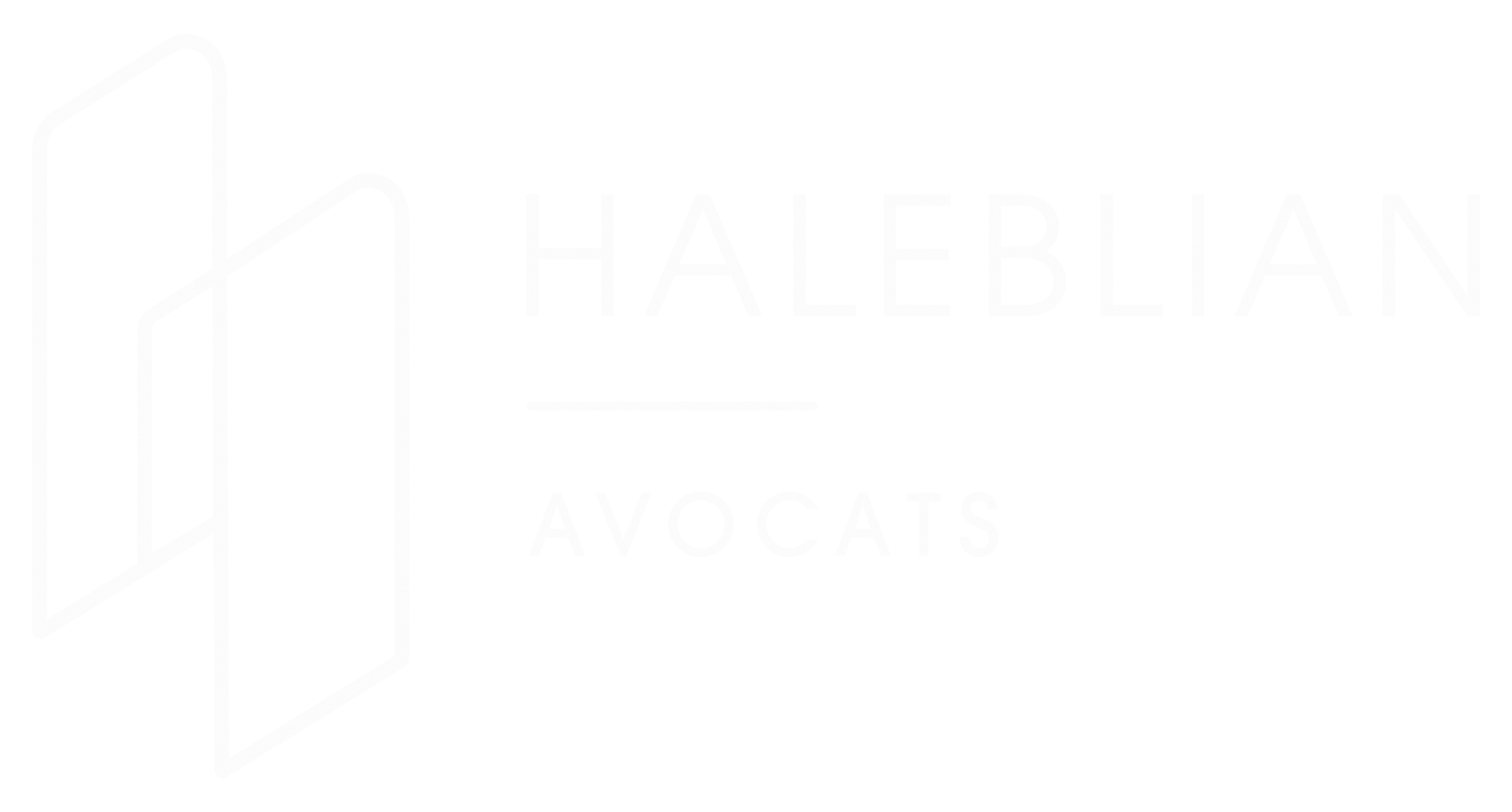Divorce, droit de secours et logement commun
Mieux
comprendre
Le mariage fait naître un ensemble de droits et de devoirs entre les époux, notamment le secours et l’assistance tels que rappelés à l’article 212 du Code civil. Lorsque les époux décident de divorcer, ces obligations ne cessent pas immédiatement.
Le temps de la procédure de divorce comme son prononcé peuvent aboutir à la condamnation de diverses pensions et indemnités du conjoint le plus fortuné au profit de l’autre.
Il en existe deux types : le devoir de secours qui prend la forme d’une pension alimentaire mensuelle et la prestation compensatoire qui correspond généralement à un capital versé en une fois.
Ces deux pensions peuvent être perçues par le conjoint le moins fortuné sous réserve que les critères prévus par la loi pour le versement de chacune soient démontrés.
En effet, la condamnation au paiement du devoir de secours ne signifie pas pour autant que le conjoint ayant les revenus les plus significatifs sera condamné au paiement d’une prestation compensatoire.
La condamnation au devoir de secours et son versement
Le devoir de secours est une mesure provisoire ordonnée par le juge aux affaires familiales. Elle est accordée au conjoint qui démontre la nécessité d’avoir une aide familiale mensuelle de la part de son époux afin d’assurer sa subsistance.
Elle peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée chaque mois ou la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ou encore une forme mixte.
Si la jouissance du domicile conjugal est accordée à titre gratuit, le conjoint ne pourra pas demander d’indemnité d’occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial.
À quelle date s’arrête le devoir de secours si un jugement a été rendu?
Le devoir de secours prend fin au moment du divorce, comme le prévoit l’article 270 du Code civil.
Selon l’article 260 du Code civil, la dissolution du mariage intervient uniquement lorsque le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, autrement dit lorsque les voies de recours auront été épuisées.
Il est donc important de procéder à la signification du jugement pour qu’il devienne définitif.
En cas d’appel, si le fondement du divorce n’est pas remis en cause, la dissolution du mariage est considérée comme définitive.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un avis du 20 avril 2022 en retenant que :
« Il s’ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquiert force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée. »
Autrement dit, si le demandeur au divorce a obtenu satisfaction sur le fondement de celui-ci, son appel ne remet pas en cause le caractère définitif de la dissolution du mariage ; ce qui fait cesser le devoir de secours.
L’obtention d’un devoir de secours n’impose pas une condamnation au versement d’une prestation compensatoire
Quand bien le juge aux affaires familiales a accordé au conjoint dans le besoin une pension alimentaire qualifiée de devoir de secours, cela ne signifie pas pour autant qu’une prestation compensatoire sera accordée à ce conjoint.
En effet, dans un arrêt du 13 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle l’autonomie du devoir de secours par rapport à la prestation compensatoire.
Elle précise que la jouissance du domicile conjugal accordée gratuitement au titre du devoir de secours n’a pas à être prise en compte pour apprécier l’existence d’une disparité et donc calculer une prestation compensatoire pour cette raison.
La condamnation au versement d’une prestation compensatoire lors du prononcé du divorce
La prestation compensatoire est une indemnité versée par l’époux à son conjoint afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Une telle prestation peut être refusée par le juge si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire n’est pas attribué d’office par la juge dès le prononcé du divorce.
Elle est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Plus précisément, la loi impose au juge aux affaires familiales de prendre notamment en considération :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux.
Autrement dit, il ne s’agit pas d’attribuer une prestation compensatoire parce qu’il existe une disparité de ressource et des charges entre les époux.
La prestation compensatoire exige que l’on justifie plutôt que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l’un ou de l’autre.
Pour compenser le versement d’une prestation compensatoire, il peut être mentionné les droits prévisibles de l’époux demandeur comme notamment l’existence d’un patrimoine commun.
Afin de connaître l’étendue de vos droits et apprécier la stratégie à mener, il est important d’être conseillé par un Avocat.
Maître Natacha HALEBLIAN, Avocate intervenant en droit de la famille, se tient à votre disposition pour vous aider et vous assister dans vos démarches.