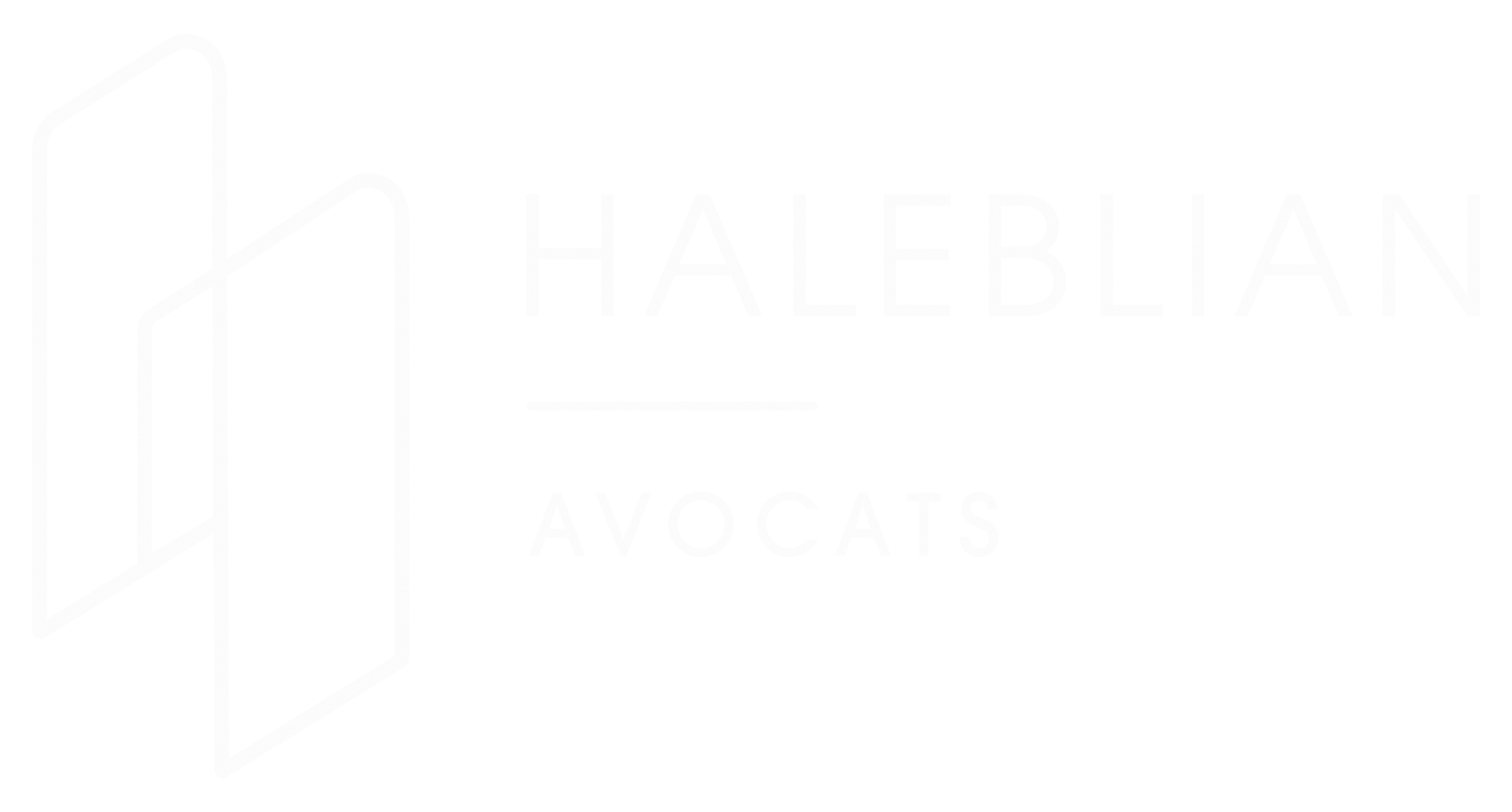Alors même qu’il s’agit d’une notion au cœur des débats dans la société française et devant les juridictions en matière de violences conjugales, cette notion n’est pas consacrée par le droit français alors qu’elle est érigée en infraction dans plusieurs pays de droit anglo-saxon (Angleterre, Pays de Galles, Irlande, Écosse, Australie), et légalement définie dans d’autres (en Belgique depuis une loi du 13 juillet 2023).
Maître Natacha HALEBLIAN, Avocat intervenant en droit de la famille au soutien des victimes, est amenée régulièrement à traiter des dossiers conflictuels avec des violences physiques et psychologiques.
Elle a pu constaté que cette notion, ignorée par le droit il y a quelques années, est de plus en plus utilisée par la jurisprudence pour condamner des auteurs de violences conjugales.
A titre d’exemple, la Chambre des appels correctionnels de Poitiers a rendu cinq arrêts le 31 janvier 2024 dans lesquelles elle condamne des auteurs en ayant identifié tous les éléments du contrôle coercitif.
Ces décisions ne sont pas isolées, de sorte qu’il est nécessaire de rappeler le cadre du contrôle coercitif.
Quelle distinction entre contrôle coercitif, violence psychologique et emprise ?
Bien que ces trois notions soient souvent utilisées de manière interchangeables, elles ont une signification différente.
Le contrôle coercitif se définit comme « un acte délibéré ou un schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, un/e partenaire intime ou un/e ex-partenaire, dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et/ou de la priver de sa liberté d’action. »
Les agresseurs utilisent divers agissements pour exercer leur contrôle sur leur victime dont l’intimidation, l’humiliation, la surveillance, la manipulation, ou encore l’isolement.
Par ailleurs, la violence psychologique décrit certains aspects du contrôle coercitif.
Cependant, certains éléments sont exclus de la violence psychologique et entrent dans le champ du contrôle coercitif comme les abus sexuels, les violences physiques, les violences économiques ou encore le stalking (harcèlement).
Quant à l’emprise, ce terme signifie être sous l’influence ou la domination d’une autre personne. Il s’agit donc de ce que vit la victime, ce qui n’est qu’un aspect du contrôle coercitif.
Vous l’aurez donc compris, l’emprise et la violence psychologique sont des composantes du contrôle coercitif sans que ces aspects soient exhaustifs.
Le contrôle coercitif est-il reconnu par la justice ?
La loi ne définit pas et n’incrimine pas en tant que tel le contrôle coercitif mais les violences conjugales au sens large.
Il est également fait référence à la notion d’emprise à l’article 226-14 du Code pénal qui autorise le médecin à lever le secret médical face à une situation de violences conjugales ; ou encore à proscrire le recours à la médiation dans les affaires familiales.
Jusqu’à récemment, la notion de contrôle coercitif n’était pas réellement saisie par les juridictions.
Néanmoins, depuis peu, de plus en plus de Tribunaux et Cours d’appel ont recours à la notion de contrôle coercitif pour identifier une situation de violences conjugales et condamner les auteurs.
A titre d’exemple, dans les cinq arrêts rendus par la Cour d’appel de Poitiers, cette dernière prend soin d’identifier ce qu’elle appelle « les outils de contrôle coercitif », lesquels permettent de dégager une définition de la notion qui fait écho à celle proposée en doctrine.
La Cour relève ainsi que « les agissements… (de l’auteur) sont divers et cumulés » et que, « pris isolément, ils peuvent être relativisés. Identifiés, listés et mis en cohérence, ils forment un ensemble ».
C’est précisément ici l’intérêt du contrôle coercitif que de réunir, sous une même notion, un ensemble d’actes tendus vers le même objectif de contrôle et d’assujettissement de la victime et qui, sans cette notion commune, seraient traités de manière isolée, voire seraient ignorés.
Pour autant, et parce que le contrôle coercitif est un schéma de violence et non encore une qualification pénale, les cinq arrêts prennent soin de caractériser en tous leurs éléments les infractions réalisées, celles-ci étant différentes selon les cas d’espèce.
Pour reprendre les termes de la Cour d’appel, celle-ci constate que l’ensemble des faits s’analyse comme « la mise en place d’un contrôle coercitif » dans lequel l’infraction caractérisée « se contextualise ».
L’évolution juridique et judiciaire du traitement des violences conjugales par la reconnaissance du contrôle coercitif par les juridictions est donc bienheureuse pour les victimes.
Si vous êtes victime de violences conjugales, Maître Natacha HALEBLIAN, se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans vos démarches lors d’un rendez-vous.