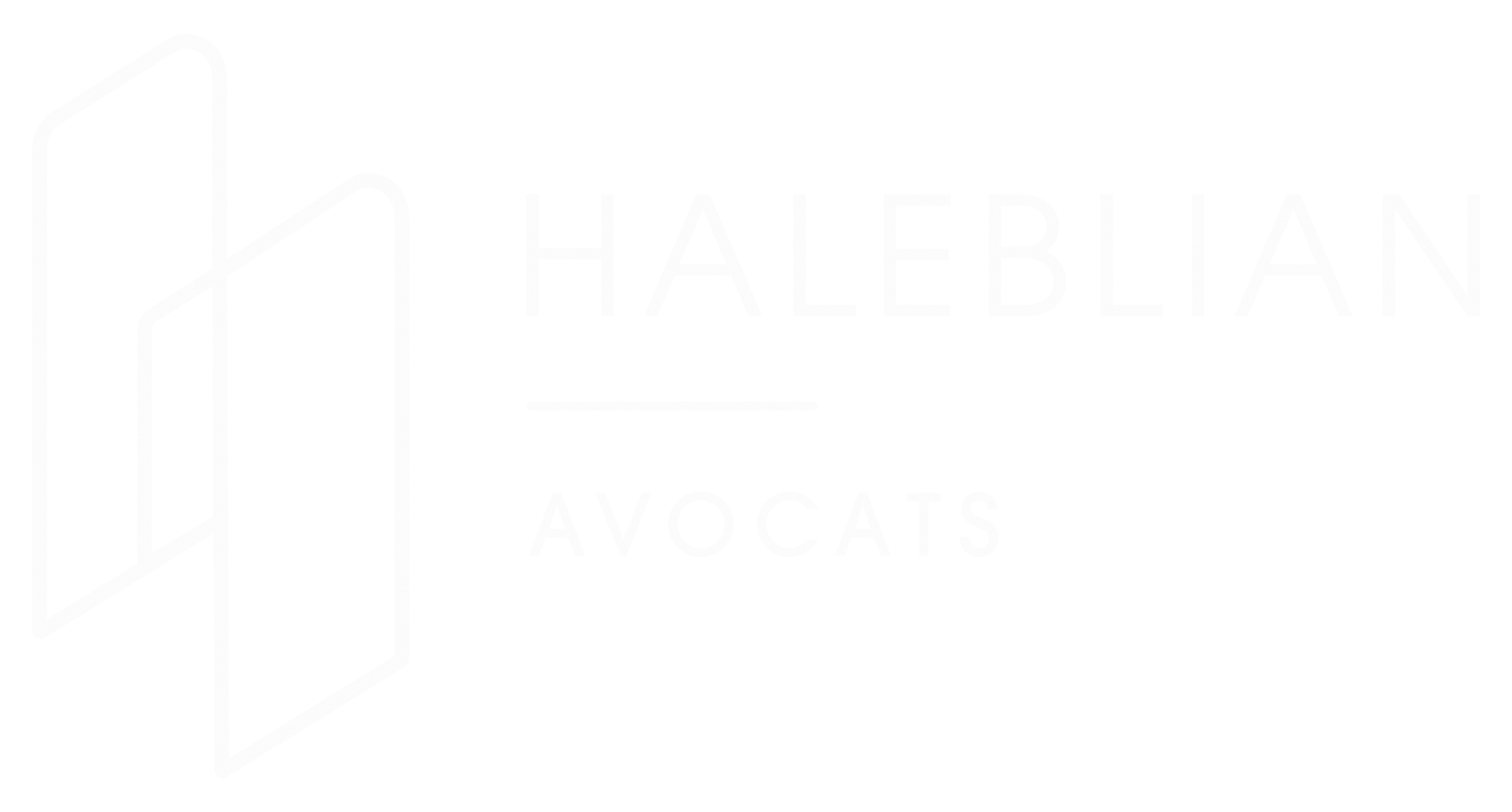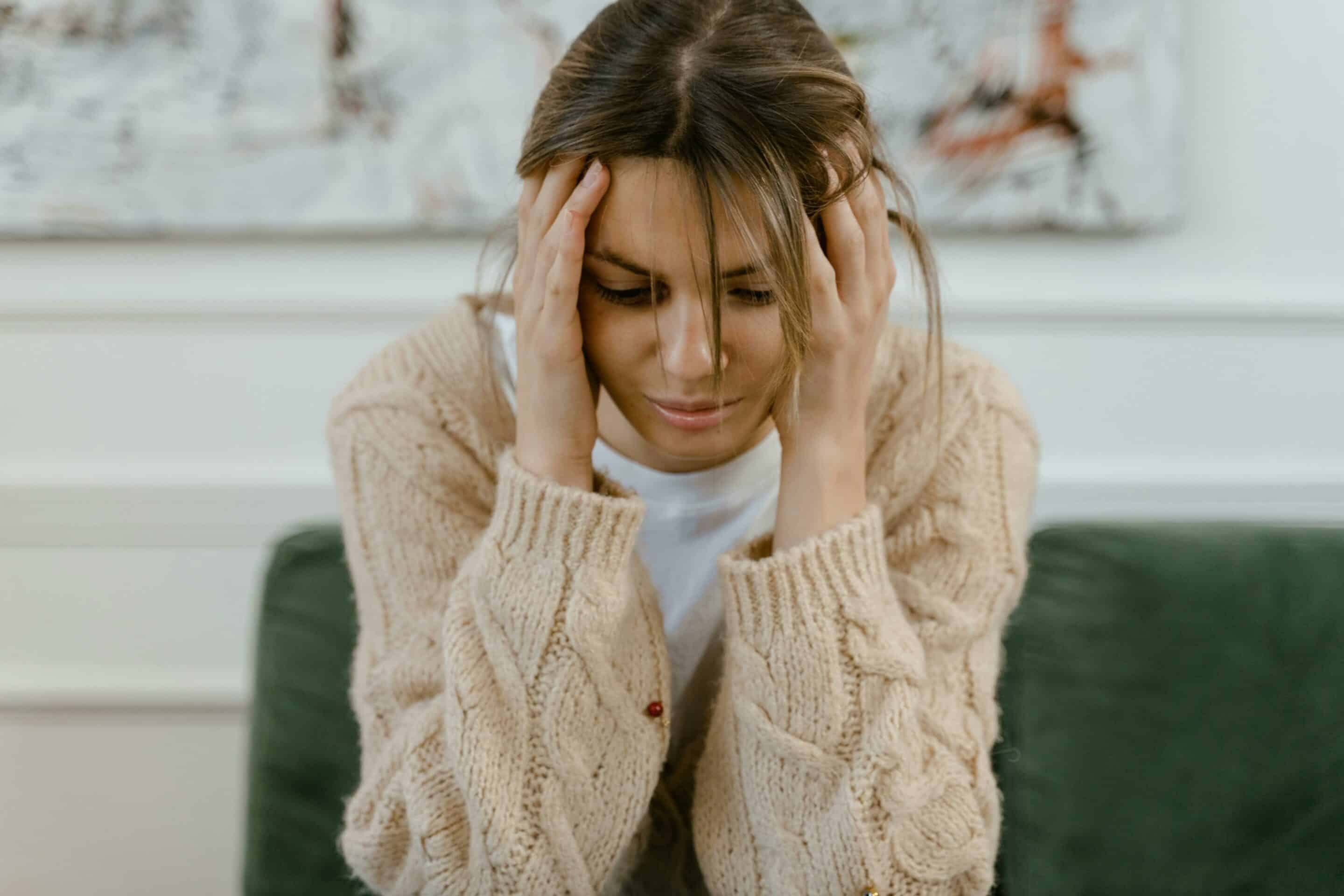Être victime d’un accident, d’une agression ou d’une erreur médicale bouleverse une vie.
Au-delà de la douleur physique ou morale, il y a souvent des conséquences économiques, familiales, voire psychologiques.
Dans ces situations, le droit à l’indemnisation existe pour permettre à la victime d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice.
Le principe : réparer, pas offrir
L’indemnisation n’est pas un cadeau.
C’est un droit reconnu par la loi française :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
(article 1240 du Code civil)
Concrètement, cela signifie qu’une personne ou une entité responsable d’un dommage doit compenser les conséquences de ce dommage.
L’objectif est simple : remettre la victime, autant que possible, dans la situation où elle se trouvait avant l’accident.
On ne peut pas effacer la douleur ou l’épreuve, mais on peut réparer financièrement ce qui a été perdu ou subi.
Qui peut prétendre à une indemnisation ?
Toute victime d’un dommage peut y prétendre, qu’il soit :
- corporel (blessures, séquelles, douleurs),
- matériel (détérioration de biens, véhicule endommagé, perte financière),
- moral (souffrance psychologique, angoisse, perte d’un proche).
Cela concerne autant :
- les conducteurs, passagers ou piétons victimes d’un accident de la route,
- que les patients victimes d’une erreur médicale,
- ou encore les victimes d’agression.
Chaque situation est unique, mais le principe de base reste le même :
celui qui cause un dommage doit le réparer.
Les postes de préjudice : tout ce qui peut être réparé
L’évaluation du préjudice se fait à travers plusieurs postes d’indemnisation, établis notamment par la nomenclature Dintilhac, utilisée par les tribunaux et les assureurs.
Parmi les plus courants, on retrouve :
- Les souffrances endurées (physiques et morales)
- Le préjudice esthétique
- La perte de revenus pendant la convalescence
- Le préjudice d’agrément (impossibilité de pratiquer une activité)
- La perte d’autonomie
- Les frais médicaux et d’assistance
- L’aide d’une tierce personne
- Et pour les proches : le préjudice moral d’affection
Chaque poste est étudié individuellement, puis évalué financièrement.
Le rôle de l’avocat : défendre, évaluer, maximiser
Face à une compagnie d’assurance, une victime est rarement sur un pied d’égalité.
Les offres d’indemnisation sont souvent inférieures à ce que la loi permet réellement d’obtenir.
C’est pourquoi l’intervention d’un avocat est essentielle.
Son rôle est de :
- analyser le dossier dans le détail,
- faire reconnaître tous les postes de préjudice,
- négocier ou plaider pour obtenir la meilleure réparation possible.
Un avocat connaît les barèmes, les jurisprudences et les pratiques des compagnies d’assurance.
Il veille à ce que chaque euro corresponde à la réalité du dommage subi.
Si vous êtes victime, ne restez pas seul face aux démarches.
L’indemnisation n’est pas une faveur : c’est votre droit.
Et obtenir la juste réparation, c’est souvent le premier pas vers la reconstruction.
Maître Natacha Haleblian a pour objectif de vous obtenir la meilleure indemnisation possible. Vous pouvez sans attendre simuler le montant de vos indemnités grâce au simulateur en cliquant ici.