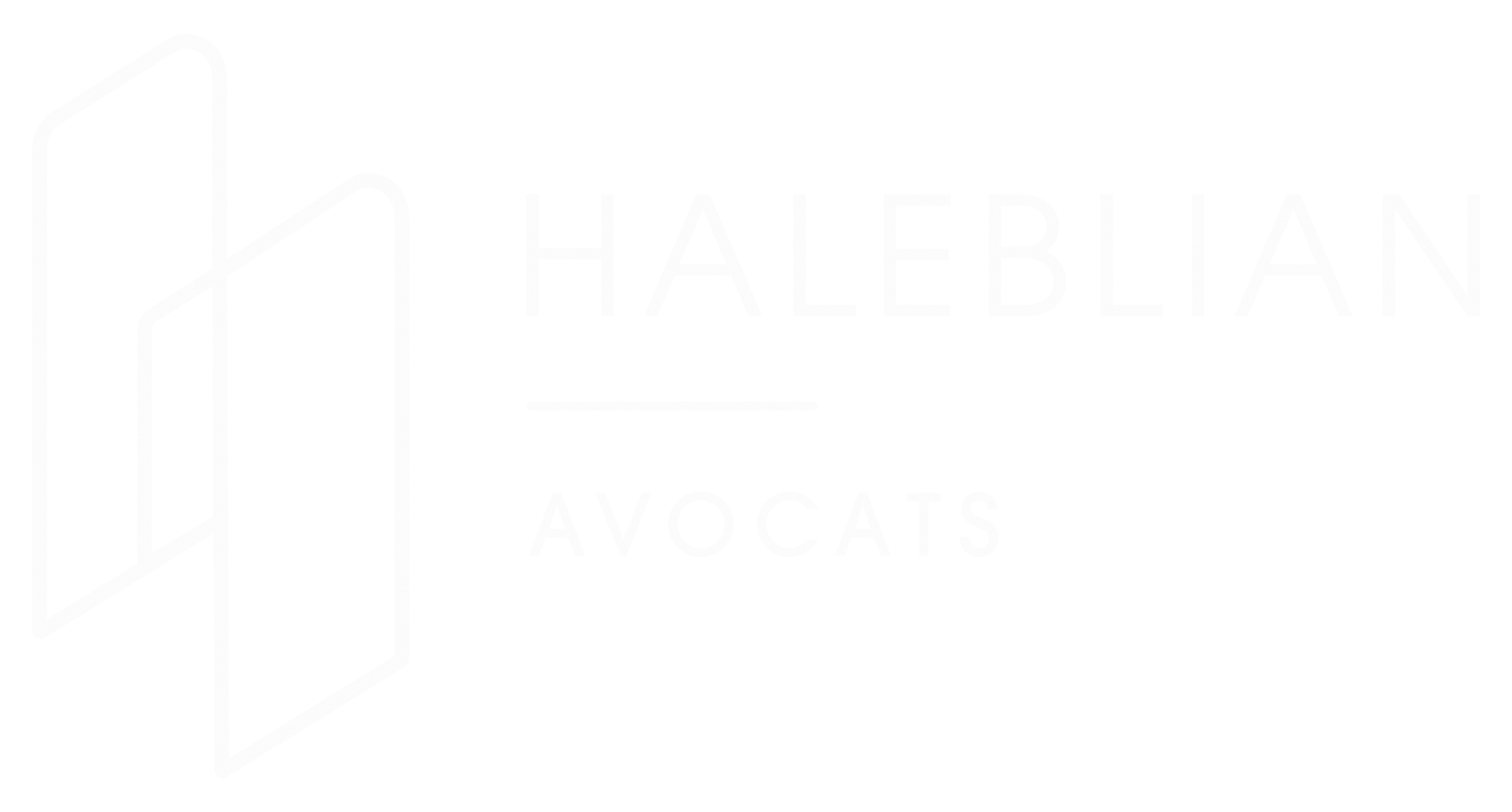Affaire Gérard Depardieu
Le 13 mai 2025, il a été reconnu pour la première fois dans une décision pénale française le préjudice de victimisation secondaire.
Le tribunal correctionnel de Paris l’a admis au profit des victimes reconnues de Gérard Depardieu.
Ce préjudice, déjà consacré en droit européen et appliqué depuis une dizaine d’années, a été mis en lumière auprès du grand public par ce procès très médiatique. Cependant, si cette reconnaissance est bien heureuse pour les victimes, on déplore que la motivation se soit concentrée sur les propos tenus par l’Avocat de Gérard Depardieu dans ce propos, essuyant de nombreuses critiques pour avoir tenus des propos humiliants
Ce procès est l’occasion de rappeler quels sont les contours du préjudice de victimisation secondaire.
Définition de la notion de victimisation secondaire
La victimisation secondaire se définit, selon le comité des ministres des Etats membres du Conseil de l’Europe le 14 juin 2006 comme « la victimisation qui résulte non pas directement de l’acte criminel mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et les individus ».
Il s’agit donc à la fois d’un dommage et d’un préjudice puisque l’objectif est de constater que la victime d’un acte délictuel / criminel subit un traumatisme en raison du traitement judiciaire et social qui lui est réservé dans le cadre de son parcours judiciaire ; ouvrant aussi la voie à la réparation d’un préjudice pour cette atteinte
Consécration de la notion de victimisation secondaire par la Cour européenne des droits de l’homme
Cette notion est apparue pour la première fois l’arrêt Y. c/ Slovénie du 28 mai 2015 (CEDH 28 mai 2015, n° 41107/10) ; et a évolué jusqu’à la consécration d’une obligation positive pour les Etats de protéger les victimes, à savoir leur image, leur dignité et leur vie privée.
Cette atteinte est fondée sur l’application des articles 3 et 8 de la Convention EDH, respectivement relatifs à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants et le droit au respect de la vie privée.
Deux illustrations récentes témoignent d’une réelle volonté de la Cour EDH d’assurer un meilleur traitement des victimes dans leur parcours judiciaire.
En effet, dans son arrêt du 27 mai 2021, J.L c/ Italie (CEDH 27 mai 2021, n° 5671/16), elle motive sa condamnation de l’Italie ainsi :
« La Cour est convaincue que les poursuites et les sanctions pénales jouent un rôle crucial dans la réponse institutionnelle à la violence fondée sur le genre et dans la lutte contre l’inégalité entre les sexes. Il est dès lors essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice ».
Plus récemment, dans un arrêt du 24 avril 2025, la CEDH a condamné la France concernant le traitement de sa plainte pénale pour viol par l’autorité judiciaire et les détails extraits de la procédure pour en déduire un consentement alors qu’elle était pour en extraire un consentement (CEDH 24 avr. 2025, L. et autres c/ France, nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22) :
« La Cour rappelle en second lieu que les articles 3 et 8 de la Convention mettent également à la charge des États une obligation positive procédurale. […]
Si cette exigence n’impose pas que toute procédure pénale se solde par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes, pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance d’actes illégaux.
[…]
Pour être effective, l’enquête menée doit être suffisamment approfondie et objective. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, par exemple en recueillant des dépositions de témoins, des expertises et des éléments médicolégaux.
[…]
Dans son appréciation du respect par l’État de ses obligations positives, la Cour tient compte de l’importance de protéger les droits des victimes. Les procédures pénales relatives à des infractions à caractère sexuel sont souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré au prévenu (Y. c. Slovénie, no 41107/10, § 103, 28 mai 2015, et X c. Grèce, précité, § 70).
Dans la conduite de la procédure, en parallèle avec le respect effectif des droits de la défense, les autorités judiciaires doivent veiller à protéger l’image, la dignité et la vie privée des victimes présumées de violences sexuelles, y compris par la non‑divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits.
Aux yeux de la Cour, il est essentiel qu’elles évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisants propres à décourager la confiance des victimes dans la justice (Y. c. Slovénie, précité, §§ 97 et 101‑104, et J.L. c. Italie, précité, §§ 137-141) ».
Les contours de la notion de victimisation secondaire
La victime qui a déjà subi un acte criminel, a le courage de le faire savoir en alertant l’autorité judiciaire. Elle doit donc bénéficier d’une prise en charge de qualité à tous les stades de la procédure, quel que soit l’intervenant concerné.
La victime a ainsi le droit à : l’accueil, l’écoute, à être entendue, à l’enregistrement des déclarations, à être orientée, à être défendue, et d’accéder à des professionnels compétents.
La procédure judiciaire ne doit pas ajouter une souffrance et une douleur à la victime autre que celle d’avoir à exposer les faits dont elle a été victime.
L’idée est donc, d’une certaine façon, de juger l’institution judiciaire sur la manière dont la victime a été traitée tout au long du parcours judiciaire.
La condamnation de Gérard Depardieu pour victimisation secondaire par le Tribunal correctionnel de Paris
Le 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Gérard Depardieu à indemnisation les victimes au titre de leur préjudice moral pour victimisation secondaire.
Pour rappel, le tribunal correctionnel motive sa décision, après avoir rappelé que la procédure pénale comme les délais d’audiencement avaient été menés dans des temps raisonnables où chacun avait pu s’exprimer, ainsi :
« Le tribunal considère qu’elles ont été exposées à une dureté excessive des débats à leur encontre, allant au-delà des contraintes et des désagréments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, au respect du principe du contradictoire et à l’exercice légitime des droits de la défense.
Si les droits de la défense et la liberté de parole de l’avocat à l’audience sont des principes fondamentaux du procès pénal, ils ne sauraient toutefois justifier des propos outranciers ou humiliants, portant atteinte à la dignité des personnes ou visant à les intimider.
En l’espèce, les parties civiles ont été confrontées à une défense particulièrement offensive, reposant sur l’usage répété de propos manifestement inutiles à l’exercice des droits de la défense, et destinés à les heurter.
[…] Ce dénigrement objectivable, constitutif d’une victimisation secondaire a engendré un préjudice distinct de celui lié à l’infraction elle-même. Ce préjudice, venant aggraver le dommage initial, doit faire l’objet d’une indemnisation spécifique ».
Or, Gérard Depardieu pouvait-il être condamné pour victimisation secondaire ?
Au regard des développements qui précèdent et à l’aune de la jurisprudence de la Cour EDH, la réponse est négative.
En effet, l’autorité judiciaire n’est pas en cause mais les propos tenus par l’Avocat de Gérard Depardieu, ce dernier ne pouvant d’ailleurs se voir condamner pour un dommage qu’il n’a pas commis.
En réalité, ce que la juridiction a voulu sanctionner sont les propos humiliants, dégradants, qui excédaient la liberté de défendre.
Sur ce point, nombreux sont les Avocats qui considèrent que l’Avocat dispose d’une immunité de parole absolue pour défendre son client, au sens de l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d’expression.
En réalité, c’est se méprendre sur le sens et la portée de ce texte.
En effet, l’alinéa 5 de l’article 41 de ladite loi dispose que « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
Surtout, l’Avocat doit concilier la liberté de défendre avec le respect des principes attachés à son serment dont le principe d’humanité.
Peut-on considérer que l’Avocat qui injure une victime qui dépose à la barre, l’humilie respecte le principe d’humanité ? Assurément non.
Peut-on considérer que ces propos, relayés largement dans les médias nationaux ne créent aucun impact pour les victimes qui ont déjà eu le courage de dénoncer les faits dont elles ont été victimes contre un acteur extrêmement connu, les réitérer à la barre du tribunal face à une défense extrêmement virulente ne créé aucun impact ? Assurément non.
En revanche, et indépendamment de la police de l’audience qui doit être assurée par les juges, on peut considérer que le préjudice qui découle de la virulence de l’attitude de l’Avocat aurait dû faire l’objet d’une autre instance, d’un autre procès ; ses propos ne pouvant pas à eux seuls caractériser une victimisation secondaire.