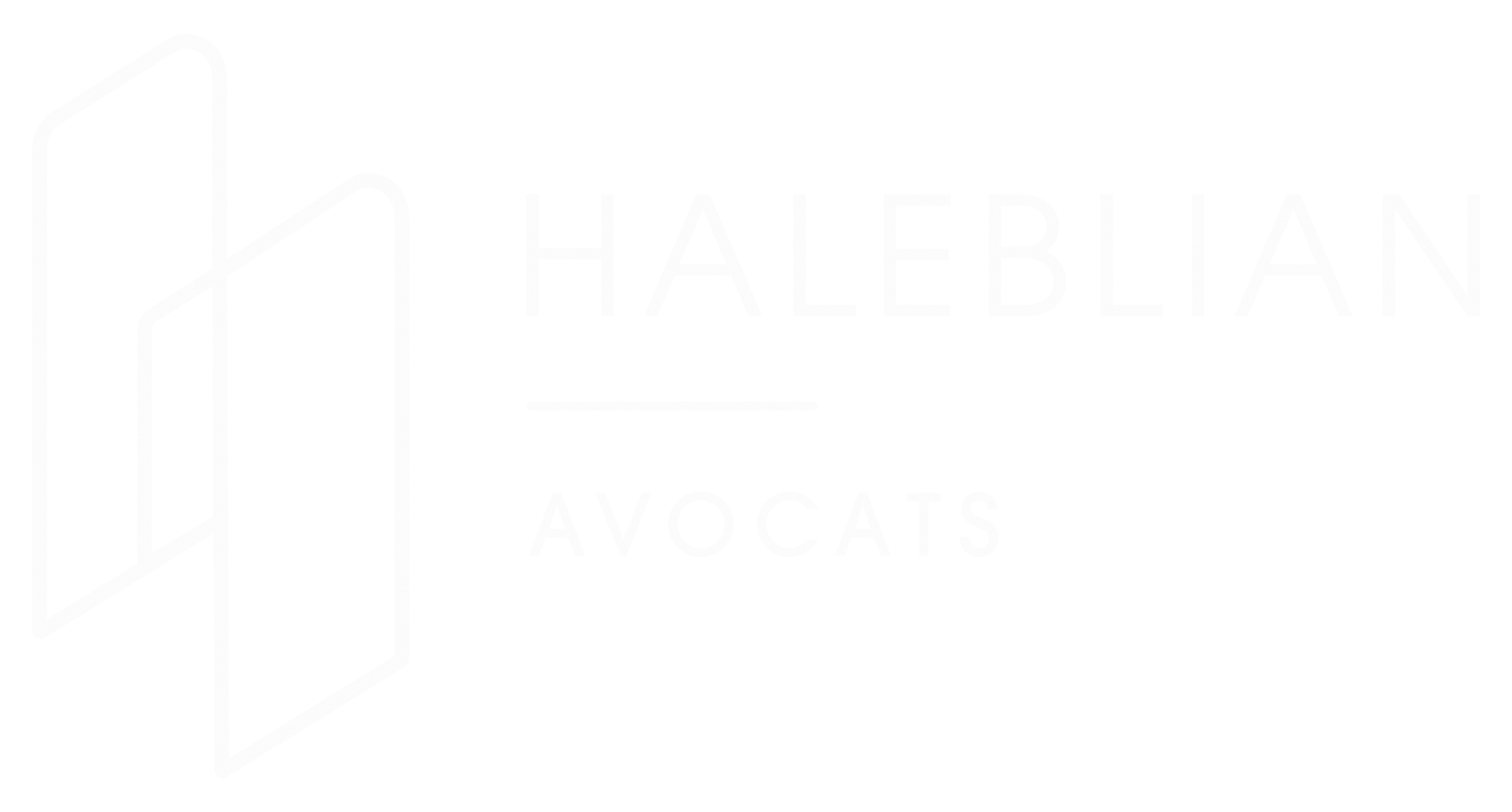L’Infection nosocomiale
Mieux
comprendre
Une infection nosocomiale est une infection contractée par un patient au cours de son hospitalisation ou lors d’un soin médical. Selon l’article R.6111-6 du Code de la santé publique, une infection est considérée comme nosocomiale lorsqu’elle apparaît au moins 48 heures après l’admission dans un établissement de santé ou après un soin ambulatoire.
Ces infections peuvent être causées par des bactéries, virus ou champignons et toucher divers organes (pneumopathies, septicémies, infections urinaires, etc.). Elles résultent souvent de la présence de germes résistants aux antibiotiques.
La jurisprudence a précisé les critères d’identification des infections nosocomiales. L’arrêt du 29 juin 1999 (CE, n° 185307, Hôpital Joseph Imbert d’Arles) a retenu qu’une infection post-opératoire pouvait être qualifiée de nosocomiale même en l’absence de faute de l’établissement hospitalier.
Qui est responsable en cas d’infection nosocomiale
Responsabilité des établissements de santé et des professionnels
La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, a posé un principe fort : la responsabilité des établissements de santé pour les infections nosocomiales est automatique, sauf cas de force majeure ou cause étrangère.
L’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique dispose ainsi que : « Les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère.«
Autrement dit, le patient n’a pas à prouver la faute de l’établissement pour être indemnisé. Il suffit de démontrer que l’infection a été contractée durant les soins.
L’arrêt du 21 juin 2011 (Cass. Civ. 1re, n° 10-18.591) a confirmé cette responsabilité automatique, en précisant que même si l’établissement prouve avoir respecté les protocoles d’asepsie, il reste responsable de l’infection.
Toutefois, les professionnels de santé exerçant en libéral (médecins, dentistes, infirmiers) ne bénéficient pas de cette présomption de responsabilité. Leur faute doit être prouvée par le patient, comme l’a rappelé l’arrêt du 9 novembre 2004 (Cass. Civ. 1re, n° 03-11.279).
L’exception de la cause étrangère
Un établissement peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que l’infection résulte d’une cause étrangère, telle que :
- Une pathologie préexistante du patient.
- Une infection liée à un germe extérieur à l’établissement.
- Un comportement fautif du patient (non-respect des consignes de soins).
La jurisprudence a cependant posé des exigences strictes pour admettre cette exonération. Dans l’arrêt du 10 juillet 2013 (CE, n° 347229), le Conseil d’État a rejeté la cause étrangère invoquée par un hôpital, estimant que l’infection était liée aux conditions d’hygiène internes.
Je suis victime d’une infection nosocomiale, comment être indemnisé ?
Procédure d’indemnisation
Lorsqu’un patient contracte une infection nosocomiale, il peut :
- Engager la responsabilité de l’établissement de santé devant un tribunal (si l’infection a entraîné un dommage grave).
- Saisir la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) pour obtenir une indemnisation rapide.
- Faire appel à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en cas de dommage grave.
L’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique prévoit que l’ONIAM indemnise les victimes si l’infection a entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ou en cas de décès.
L’arrêt du 23 novembre 2017 (Cass. Civ. 1re, n° 16-24.503) a rappelé que l’ONIAM est tenu d’indemniser les victimes même en l’absence de faute, dès lors que les critères de gravité sont remplis.
Montant et nature des indemnisations
L’indemnisation couvre :
- Les préjudices corporels : douleurs, séquelles, invalidité.
- Les préjudices économiques : perte de revenus, adaptation du logement.
- Les préjudices moraux : souffrance psychologique, atteinte à la qualité de vie.
Dans un arrêt du 26 septembre 2019 (CE, n° 420299), le Conseil d’État a condamné un CHU à verser une indemnisation de 1,2 million d’euros à un patient victime d’une infection nosocomiale ayant entraîné une amputation.
Les mesures de prévention et d’amélioration du contrôle des infections nosocomiales
Face à la gravité des infections nosocomiales, des actions ont été mises en place pour renforcer la prévention :
- Obligation de signalement des infections nosocomiales (article L.6111-1-2 du Code de la santé publique).
- Mise en place de comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) dans chaque hôpital.
- Renforcement des protocoles d’hygiène et des contrôles sanitaires.
Malgré ces efforts, la jurisprudence souligne régulièrement des manquements. L’arrêt du 17 février 2017 (Cass. Civ. 1re, n° 16-10.195) a condamné un hôpital pour absence de traçabilité des mesures de désinfection, ce qui a empêché de prouver que les infections constatées ne provenaient pas de ses services.
Je suis victime d’une infection nosocomiale, dois-je prendre un Avocat ?
Les infections nosocomiales représentent un risque majeur pour les patients hospitalisés. La loi et la jurisprudence ont mis en place un régime de responsabilité stricte des établissements de santé, permettant une indemnisation plus rapide des victimes. Toutefois, l’identification d’une infection nosocomiale et l’évaluation des dommages nécessitent souvent une expertise médicale approfondie. Les victimes peuvent être accompagnées par un Avocat spécialisé pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation juste et complète. Maître HALEBLIAN, spécialisée en droit du dommage corporel, vous accompagne pour défendre droits et obtenir une indemnisation à la hauteur du préjudice que vous avez subi. Vous pouvez prendre un premier rendez-vous pour faire le point sur votre situation.