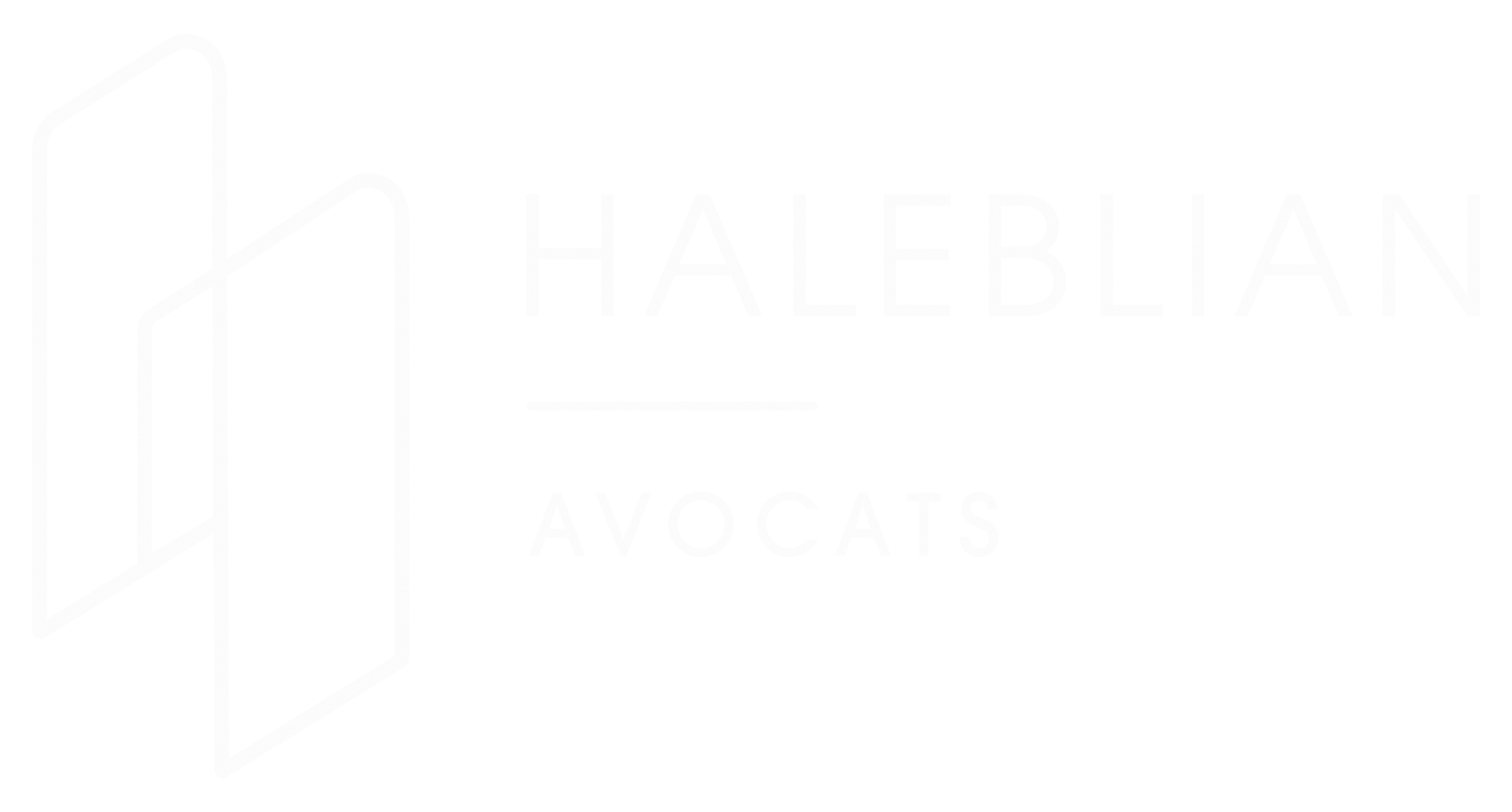Accidents de la circulation
Mieux
comprendre
Définition de l’accident de la circulation
Un accident de la circulation est défini par la jurisprudence comme un événement survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, impliquant au moins un véhicule terrestre à moteur (VTAM). Cette définition est issue de l’interprétation de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, qui constitue le texte de référence en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Article 1er de la loi : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.«
Qui peut être indemnisé ?
La loi Badinter distingue trois catégories de victimes :
- Les victimes non conductrices (piétons, cyclistes, passagers) bénéficient d’un régime très protecteur. Leur indemnisation est automatique, sauf en cas de faute inexcusable.
- Les conducteurs de VTAM : leur indemnisation dépend de l’absence de faute ou d’un contrat de garantie corporelle.
- Les ayants droit : en cas de décès, la famille proche (conjoint, enfants, parents) peut obtenir réparation du préjudice moral et économique.
Une jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le cycliste, bien qu’il soit actif sur la voie publique, est assimilé à un tiers non conducteur, et bénéficie donc de l’indemnisation de plein droit prévue à l’article 3 de la loi Badinter (Cass. Civ. 2e, 3 juin 1998, n°96-20.370).
L’indemnisation des victimes
L’assureur du véhicule impliqué doit proposer une offre d’indemnisation dans un délai de :
- 8 mois à compter de l’accident, si le dommage est consolidé.
- 5 mois après consolidation, si elle intervient postérieurement.
Cette obligation est fixée par l’article L.211-9 du Code des assurances.
Si l’offre est manifestement insuffisante ou si elle n’est pas faite dans les délais, l’assureur peut être condamné à verser des intérêts majorés (Cass. Civ. 2e, 30 avril 2003, n°01-13.017).
Responsabilité et partage des fautes
Le principe de la loi Badinter repose sur la dissociation entre responsabilité civile et indemnisation : même si l’auteur de l’accident n’est pas fautif, les victimes sont indemnisées.
Néanmoins, pour les conducteurs, une faute de conduite peut limiter voire exclure le droit à indemnisation. L’appréciation de la faute reste souveraine pour les juges, comme l’illustre l’arrêt de la 2e chambre civile du 19 mars 2009 (n°08-13.003), qui confirme l’exclusion d’un conducteur ivre responsable de sa propre chute.
Cas particulier des vélos, trottinettes et autres nouveaux moyens de transport
Les piétons et cyclistes sont particulièrement protégés. Même en cas d’imprudence ou de faute légère (traversée en dehors des clous, par exemple), ils bénéficient d’une présomption de droit à indemnisation, sauf preuve d’une faute inexcusable, définie comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. Civ. 2e, 20 juillet 1987, n°86-10.423).
Le vélo classique (sans moteur)
Le cycliste utilisant un vélo sans moteur est considéré par la loi Badinter comme un tiers non conducteur de véhicule terrestre à moteur (VTAM).
Il bénéficie donc d’une protection renforcée : il a droit à une indemnisation intégrale, sauf s’il a commis une faute inexcusable (article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 1998 (Civ. 2e, n°96-20.370), a clairement affirmé qu’un cycliste heurté par un véhicule motorisé, même en ayant traversé sans précaution, ne perd pas automatiquement son droit à indemnisation.
Le vélo à assistance électrique (VAE)
La situation est différente selon la puissance et la vitesse du vélo :
- Si le vélo respecte les critères de l’article R.311-1 du Code de la route (assistance limitée à 25 km/h et puissance ≤ 250 watts), il n’est pas considéré comme un VTAM.
Le cycliste reste protégé par la loi Badinter comme un simple usager non motorisé. - En revanche, si le vélo dépasse ces limites (assistance sans pédalage, puissance > 250W ou vitesse > 25 km/h), il devient juridiquement un véhicule terrestre à moteur.
Le cycliste est alors assimilé à un conducteur de VTAM, et sa faute peut limiter voire exclure son indemnisation, au même titre qu’un automobiliste.
Conseil pratique : bien vérifier les caractéristiques techniques de son VAE avant d’engager une action, car cela influence la recevabilité du recours et la nature du régime d’indemnisation.
Les trottinettes électriques et autres EDPM
Les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), comme les trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards, sont désormais encadrés par la loi LOM du 24 décembre 2019 et le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019.
Depuis ces textes, ils sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur, dès lors qu’ils sont motorisés et dépassent 6 km/h.
Les utilisateurs de ces engins sont exclus du régime protecteur de l’article 3 de la loi Badinter, comme les conducteurs de voitures ou motos.
Leur droit à indemnisation dépend de l’absence de faute personnelle, ou de l’existence d’un contrat de garantie corporelle conducteur.
Dans une décision du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, n° 20-17.121), la Cour de cassation a confirmé que l’usager d’une trottinette électrique était bien un conducteur de VTAM, et donc soumis au régime de responsabilité des conducteurs.
|
Type d’engin |
Statut juridique |
Régime d’indemnisation |
|
Vélo mécanique (sans moteur) |
Non-VTAM |
Victime protégée (art. 3 Loi Badinter) |
|
Vélo à assistance électrique ≤ 25 km/h |
Non-VTAM |
Victime protégée |
|
Vélo électrique > 25 km/h ou > 250W |
VTAM |
Conducteur – indemnisation si pas de faute |
|
Trottinette électrique, gyropode, etc. |
VTAM (EDPM) |
Conducteur – régime classique |
Action en justice
En cas de désaccord avec l’assureur, la victime peut :
- saisir le Tribunal judiciaire pour contester l’offre d’indemnisation ;
- demander une expertise médicale judiciaire pour évaluer précisément son dommage ;
- faire appel à un Avocat spécialisé en droit du dommage corporel, pour faire valoir ses droits.
Le délai pour agir est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage (art. L.1142-28 du Code de la santé publique).
Les accidents de la circulation relèvent d’un cadre juridique protecteur pour les victimes, notamment grâce à la loi Badinter. Cependant, la mise en œuvre de l’indemnisation reste souvent complexe, en particulier lorsqu’il s’agit de démontrer la gravité des préjudices ou de contester une offre insuffisante.
Maître Natacha HALEBLIAN, Avocate spécialisée en droit du dommage corporel depuis plus de 10 ans, accompagne les victimes d’accidents de la circulation dans toutes les étapes de leur procédure, pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices.